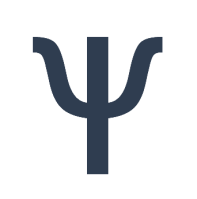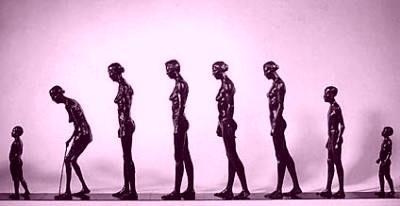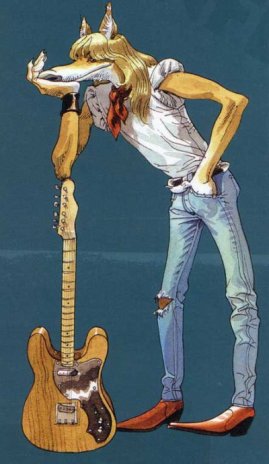A lire en écoutant : Figures – Jessie Reyez
Aujourd’hui, il s’est passé un truc exceptionnel.
La famille Crevasse a su montrer son vrai visage. De la mère au père, en passant par chaque enfant, tous ont su partager avec toute leur authenticité leurs resplendissantes qualités, leurs profondes failles, leurs doutes les plus légitimes. La famille Crevasse a dévoilé avec panache à tout un tas d’humains le pouvoir de l’authentique.
Maman Crevasse s’est présentée aux urgences en pleine nuit, illuminée de gyrophares de pompiers, avec son cortège d’humains au regard préoccupé. Sur son brancard, elle avait les yeux dans le vague, et pour seul habit une couverture, laissant percevoir timidement deux frêles bras, dessinés de veines rutilantes, la peau à même l’os. Suivait derrière ce florilège médical Papa Crevasse, le visage en peine, le pas saccadé, une bedaine de bon vivant. Ou de désespéré.
Maman Crevasse avait encore trop bu. Tout s’est précipité comme un brasier sous le soleil. S’est allé très vite. La braise était déjà là, et une grosse étincelle l’a amenée à un geste pour essayer de faire tout disparaître.
C’est pas faute de l’avoir aidé. Toute la famille le sait. Mais rien n’y a fait. Et Maman Crevasse, la valise de la vie déjà bien pleine, a du réouvrir il y a quelques jours le bagage déjà débordant. Alors même qu’elle vivait le deuil de son père, elle s’est retrouvée confrontée à l’impensable.
La famille Crevasse avait pourtant réussi à prendre des vacances dans les îles ces derniers temps. Ils avaient pu s’offrir un temps de plaisir dans un quotidien de tumulte. Ils en revenaient tout juste d’ailleurs. Eau paradisiaque, moments de famille, rires. Le cocktail parfait. Mamie Crevasse n’avait pas pu s’y joindre, mais on l’appelait un peu tous les jours pour qu’elle soit un peu là. Seulement Maman Crevasse n’avait pas eu de nouvelles ces derniers jours. Rien de grave sûrement, mais Maman Crevasse voulait rapidement passer la voir à son retour.
Elle y est alors allée, seule. Et le rien de grave se transforma en tout autre chose. Mamie Crevasse n’était plus. D’un coup. Silence complet. Temps arrêté. Tempo à zéro. Quatre tonnes d’adversité venaient subitement faire déborder la valise de Maman Crevasse. Pas beaucoup de sens à tout ça, juste un bon gros tsunami. Il faut dire, Mamie Crevasse n’avait jamais été du genre à laisser quoique ce soit au hasard. Alors quand il s’agissait de la mort, elle se devait d’être aux manettes. Sans penser que Maman Crevasse serait la première à la trouver. Sans penser qu’autour d’une personne suicidée gravite plus de 20 personnes. Victimes collatérales d’une souffrance à fragmentation.
A genoux, la valise était maintenant trop lourde pour Maman Crevasse. En rentrant, tout était flou, et seul l’alcool allait temporairement lui amener un repère. Quitte à se faire noyer par un tsunami, autant le faire sans conscience. Au risque de ne pas voir les arbres auxquels on peut se raccrocher. Ça, Papa Crevasse commençait à s’en douter. Le tsunami emmenait sa femme loin. Très loin. Mais surveiller la souffrance ne suffit parfois pas. La puissance du désespoir combiné aux profondes altérités de la vie submergent souvent plus qu’un tsunami.
C’est alors que Maman Crevasse tenta le copier-coller de la fin de vie de Mamie Crevasse. Des moyens de se suicider, il y en avait. Il y en a souvent un peu trop d’ailleurs. Heureusement, Papa Crevasse l’a trouvée rapidement. Alors pompiers. Urgences. Psychiatre.
Je reçois Maman Crevasse avec toute la famille Crevasse. Le Papa, et les trois enfants. La tribu au complet. Réunion de crise. Maman Crevasse n’est pas passée loin de la mort, mais vraiment plus près que la dernière fois. Le poids du désespoir accumulé le long d’une vie mène à plus de détermination, sûrement. Il est temps de lui tendre la main, vraiment. Mais elle ne veut pas. Oui, elle est en crise suicidaire. Mais si ce n’était que ça. Maman Crevasse est au début de son deuil. Elle veut veiller le corps de sa mère. Et se doit de le faire, elle est comme ça, point. Personne ne l’en empêchera.
« Et tant pis pour sa vie »
J’ai été à ce moment-là envahi d’un sentiment mêlé de gêne, de désarroi, de tristesse. Je devais l’hospitaliser. La mettre en sécurité pour un temps. Mais comment oser l’hospitaliser, dans ce moment si important pour le deuil ? Je n’aimerais pas entendre un médecin proposer ça pour ma propre mère. Qui suis-je pour empêcher à Maman Crevasse de faire son deuil à sa façon ? Est-ce mon rôle ou serais-je en train d’outrepasser mes devoirs? Pourtant sa tribu me l’a dit, ils ont trop peur de la perdre elle aussi. Et Maman Crevasse me l’a affirmé, elle retentera. Parce-que tout ça déborde. Et il n’y a plus d’horizon pour orienter son pas. Alors que faire quand on est face à une personne en crise, submergée par la souffrance, au point de ne plus pouvoir faire face ?
Rien n’est formellement écrit. Le soin ici, ça doit s’inventer. S’adapter. À la personne. À son état de santé. Au concret de sa réalité. Et aux limites des moyens que l’on a. Alors on doit aider à penser l’alternative, toutes les solutions, autre que la mort. Proposer de l’hospitaliser pour lever un temps la responsabilité d’une tribu envers l’une de ses membres, quand la tribu entière est elle-même en crise. Et c’est peut-être pour ça qu’on n’aime pas que les familles prennent le rôle de soignant. Pour laisser la responsabilité en dehors de la tribu, lever le poids de la culpabilité et aller au plus juste face à la souffrance. Choisir l’optimal. Parce que le parfait n’existe pas.
Je n’avais pas envie d’avancer cette décision à la famille Crevasse. Mais il n’y avait pas d’alternative à ce temps précis. L’hospitalisation courte venait là comme rempart à la mort. Le cadre comme sas de décompression, pour sortir la tête de l’eau. Maman Crevasse ne l’entendait pas comme ça, mais la vie est trop précieuse pour se permettre de la négliger sur l’autel du désespoir.
C’est alors que, quand le sujet est venu, la famille Crevasse a agi comme jamais je n’avais vu agir une famille jusqu’ici. Et c’est de tous ses membres qu’a émané la solution. Fiston Crevasse a rapidement pris la parole :
« Non mais en fait pour qu’on puisse tous faire un choix juste, là, aujourd’hui, on doit vous raconter notre histoire. »
J’étais face à cette famille, qui se croisait du regard, comme pour vérifier que toute la tribu était d’accord. Un court silence s’est installé, comme si un moment de vide devait précéder ces révélations. J’étais un peu surpris, curieux de comprendre vers où il voulait emmener cette résolution.
« En fait, moi je sors de plusieurs années à vivre dans la rue. Le crack m’a rongé, et j’en sors tout juste. Vous pouvez pas vous douter en me voyant maintenant, bien rasé, habillé, propre sur moi, mais c’était la misère. »
Je ne m’y attendais en effet pas. Gros revirement. Comme si le projecteur ne savait plus qui éclairer. Que faire de cette information? Pourquoi nous dit-il ça? C’était flou pour moi, alors je décidais de rester observateur. Il se passait quelque chose que seule cette tribu comprenait. Ils m’ouvraient leur porte. Et quand on rentre chez quelqu’un, on enlève d’abord ses chaussures et on attend.
Ma première impression, c’était bien que Maman Crevasse était dans le creux de sa vague, mais avait su construire autour d’elle un cocon solide fait d’humains d’une grande stabilité. Je devais apparemment revoir ma copie.
Un sentiment de fluide liberté de parole s’est ensuite ressenti dans la pièce. Chacun, au départ figé, a commencé à reprendre du mouvement. Et Grand-Frère Crevasse a choisi de continuer sur la lancée :
« Bon bin puisqu’on en est aux aveux… Moi je viens de prendre la décision d’aller en cure. Je suis un putain d’alcoolique. Ça a pas été facile comme décision. Personne n’aime devoir se faire hospitaliser. Mais là, c’était ça ou je crevais. Alors je comprends comme ça doit être compliqué pour Maman de choisir. »
Son regard était orienté avec insistance sur Maman Crevasse, comme pour bien lui faire comprendre que son argument lui était bien adressé.
Papa Crevasse se mit à pleurer. Comme s’il faisait enfin un bilan de sa tribu. Touché de voir la souffrance des siens. Mais aussi fier de leur courageuse authenticité. Ça faisait beaucoup d’un coup. Mais putain ça faisait du bien :
« Moi-même j’ai pas toujours été facile, j’ai grandi dans cette éducation. Mais on s’aime tous, et c’est ce qui nous tient. Alors on va survivre, et pour ça on a besoin d’aide. »
Tous avaient parlé. Seule Petite-Soeur Crevasse observait, écoutait depuis le début, les yeux parfois vers le sol, par gêne, parfois vers le haut, pour penser. Elle décida de conclure :
« Notre famille est particulière, c’est sûr. Mais ma mère là, on veut pas la perdre. Et mon père est épuisé de tout tenir. On fera ce qu’il faut pour hospitaliser notre mère, même si elle ne veut pas »
On sentait chez eux de l’hésitation, humaine, à accompagner cette décision que je devais tenir. Alors il fallait agir vite, pour éviter de la souffrance inutile.
On l’a transférée alors qu’elle voulait fuguer, pour se tuer. Le transfert pu se faire dans le calme et le respect, mais c’est un moment qui reste toujours puissant en émotion. Un mélange amer de bonne volonté, d’injustice, d’amour, de rancœur. On ne veut pas qu’elle vive ce qu’on voit dans les films, mais on ne sait pas sauver sa propre mère d’une souffrance qu’on ne connaît pas bien. Alors on leur fait rencontrer les soignants de l’unité, garantie d’une humanité qu’on préservera dans les soins avec toute l’énergie que l’on aura. Au maximum de ce que l’institution nous permet de faire. La décision n’est pas parfaite, et ce temps de soins ne fera pas tout, on le sait tous. Mais quand quelqu’un se noie devant nous, on lui tend d’abord le bras pour la sortir de l’eau avant de penser à tout le reste.
Pour Grand-Frère Crevasse, la douleur était trop grande. Dans cette décision, pleine de bienveillance et d’impuissance entre-mêlées, les larmes ont coulées. La famille Crevasse devait survivre, mais la tribu entière était malmenée.
Un sentiment de solidarité et de compassion flottait alors au sein de l’équipe de soins, et je pouvais lire l’authentique détresse dans les yeux des soignants autour. La famille Crevasse avait levé les barrières du stigma, en osant se dévoiler au plus proche du vrai, comme par instinct de survie. Et ce qui était un évènement tragique est devenu un grand moment d’authenticité, où tout le monde posait les masques. Pas de place pour le superficiel. Grand-Frère Crevasse fût reçu à l’écart, pour un café, une oreille attentive, un temps de pause. Parce que le soin parfois doit se limiter à l’essentiel.